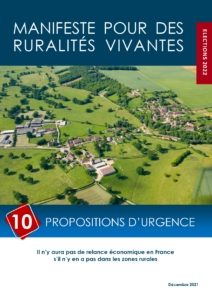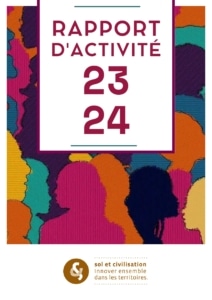RECHERCHER
Colloques
- 3 et 4 février 2022
Intervention d’Anne-Claire Vial aux Journées de l’UCLy, sur le thème « Tous vulnérables ».
Ces journées avaient pour objectif d’apporter aux participants des clés pour appréhender et accompagner la vulnérabilité dans toutes ses dimensions (économique, sociale ou encore environnementale), à l’échelle individuelle et collective, vécue dans la sphère privée ou dans le monde professionnel. Y ont assisté plus de 500 décideurs et responsables : acteurs économiques, institutionnels et politiques, du monde de la santé, de l’ESS, des ONG et acteurs associatifs. Anne-Claire Vial a participé à une table-ronde animée par Pascale Tournier, Rédactrice en chef de l’hebdomadaire La Vie, sur le sujet « Vulnérabilités, bouleversement climatique et mondialisation : quelles conséquences ? comment s’adapter ? », aux côtés de Elisabeth Ayrault, Co-présidente de la Chaire d’Université Vulnérabilités de l’UCLy, avec des interpellations de Joseph Kokou Laba, étudiant en Master de philosophie à l’UCLy.
- 28 juin 2021
Intervention d’Élise Levinson dans la table-ronde « L’âme des villages : devenir enfin vivants », organisée par l’Archipel des Alizées.
Dialogue avec Raphaël Boutin-Kuhlmann, de Villages Vivants, animation par Emmanuelle Coratti.
Cette table-ronde riche a abordé différents sujets : la difficulté autant que l’importance de (re)créer du lien à soi, aux autres, au monde et à la nature, étant donnés les défis complexes que nous avons à relever ; le rôle crucial que jouent et que joueront demain encore les territoires, notamment ruraux, comme espaces d’expérimentation, d’innovation sociale, d’émergence, mais également de rencontre entre le local et le global ; l’importance des lieux et des facilitateurs et facilitatrices stratégiques pour être, faire et vivre ensemble, durablement, dans ces territoires ; l’enjeu d’hybrider les savoirs, les expertises, les visions et les approches du monde, en particulier les approches analytiques, rationnelles, scientifiques (« cerveau gauche »), et les approches intuitives, processuelles, créatives, relationnelles (« cerveaux droit »).
Replay : https://bit.ly/3QbJk6o
Les formations
Contribution à la formation aux enjeux de la ruralité et au développement des territoires – Institut des Hautes Etudes et des Mondes Ruraux
L’IHEMRu forme les cadres dirigeants et les influenceurs à une meilleure connaissance des caractéristiques des territoires ruraux dans leurs potentiels et dans les moyens de les valoriser.
Pendant leur parcours de formation, ils explorent à travers le prisme de la ruralité, les sujets économiques et sociétaux contemporains, et des questions centrales en vue de penser l’avenir de ces territoires au regard de ce que
permettent de révéler la transition numérique, le développement durable, la gouvernance.
La pédagogie de l’IHEMRu s’appuie sur les apports de scientifiques renommés et de responsables expérimentés publics comme privés.
Le directeur de la structure Didier Christin a contribué au montage de cette formation.
Dominante d’approfondissement AgroParisTech – TERritoires, Recherche-Action, INnovationS (TERRAINS)
Quels que soient leurs domaines et leur niveau d’action, les ingénieurs ont de plus en plus besoin de mieux identifier, connaitre, faciliter, instituer, préserver, en somme contribuer à ces dynamiques territoriales. C’est l’objet de cette DA que de former à ces dispositions, au travers d’un processus d’apprentissage et d’une pédagogie adaptés combinant travaux individuels et collectifs, centrés sur la mobilisation d’expertises scientifiques et pratiques plurielles, mais aussi de différentes formes d’intelligences (rationnelles, réflexives, créatives, stratégiques…). L’accent est mis sur
les projets collectifs centrés sur des enquêtes et travaux de terrain, répondant à des problématiques territoriales actuelles, en interaction directe avec le monde professionnel.
Construction pédagogique :
La DA s’articule autour de trois pôles pédagogiques :
– Un pôle « Se situer dans les dynamiques territoriales » qui vise à appréhender sur un plan historique et dynamique les principales approches qui ont structuré et structurent aujourd’hui la façon d’identifier ce qui fait problème dans les territoires ainsi que les solutions innovantes, du point de vue social, politique, économique ou encore géographique, qui y ont été apportées.
– Un pôle « Comprendre et analyser le changement dans les territoires » qui vise à appréhender les dynamiques de changement et prendre prise sur des situations critiques dans les territoires, en convoquant différentes entrées interdisciplinaires (par les dynamiques institutionnelles,
les dynamiques de rupture ou encore par les attachements et la territorialité par exemple).
– Un pôle « Hybrider et composer l’action dans les territoires » qui vise à cultiver une posture de l’action ouverte et transversale du point de vue des ontologies, des savoirs et des outils de l’action.
La formation s’appuie sur des cas d’études centrés sur des territoires agricoles, périurbains, métropolitains, industriels ou touristiques, où se jouent des dynamiques socio-économiques actuelles (mise en tourisme, métropolisation, équipement et industrialisation…). A cet égard, trois dispositifs en particulier visent à mettre à l’épreuve les cadres d’analyse et les régimes d’innovation étudiés dans la formation. A travers des situations appliquées, ils doivent permettre d’élaborer et de tester les outils de l’ingénierie territoriale.
Les projets de recherche
- Programme de recherche AliGé
Projet de recherche “Vers une Alimentation Générale qualifiée par l’action commune en territoires” (AliGé), retenu dans le cadre de l’appel à projets publié en 2021“CO3 : Co-construction des connaissances” (financements ADEME), en partenariat avec l’UNCPIE et INRAE.
“[…] notre projet vise à comprendre pourquoi et comment certains modes de coordination et de conduite de projet, certaines postures aussi, sont mieux à même de faciliter les mécanismes de transition à l’échelle des systèmes alimentaires territoriaux ; comprendre également quelles sont les transitions à opérer dans les gouvernances habituelles pour permettre, au côté d’autres types d’apports, une transition des systèmes agri-alimentaires. Notre projet intègre 6 CPIE engagés dans des dynamiques alimentaires territoriales, sélectionnés par l’Union nationale des CPIE.”
Au cours de l’année 2021-2022, des séances d’accompagnement individuel (coaching) ont été réalisées auprès de 6 facilitateurs territoriaux (salariés de 6 CPIE différents), avec deux méthodes : mobilisation de la grille IDPA en individuel (issue de l’audit patrimonial), méthode “Tenir Conte” qui accompagne un chemin de changement en utilisant les allégories, symboles et structure de cette forme particulière de récit qu’est le conte.
Contact : elise.levinson@soletcivilisation.fr
- Programme de capitalisation « Territoires à Agricultures Positives »
En 2021 et 2022, Sol et Civilisation est en charge de la coordination générale de la démarche de capitalisation, et plus spécifiquement de la production d’enseignements stratégiques pour mieux accompagner et mettre en œuvre des dynamiques territoriales avec les agriculteurs créateurs de richesses et d’inventivité territoriale. Dans ce cadre, elle a organisé, animé et fait la synthèse d’une série de séminaires auxquels ont participé les chargés de mission des projets et les financeurs. Ces enseignements alimenteront le document de capitalisation final qui sera réalisé d’ici le premier trimestre 2023.
Contact : suzanne.hermouet@soletcivilisation.fr
Co-publications
Participation à la rédaction du Manifeste pour des Ruralités Vivantes initié par la FNSEA et porté par le Groupe Monde Rural dans la perspective des élections présidentielles et législatives de 2022
« Les territoires ruraux prennent toute leur part dans les transitions en cours et sont en capacité de répondre tant aux demandes sociétales qu’à contribuer à la réussite du Plan de Relance. Pour cela, il faut remettre, au cœur des priorités, l’activité économique des zones rurales et, bien évidemment, le vivre–ensemble que cela exige. Le rôle des entrepreneurs pour le maintien et la vitalité des territoires ruraux doit, enfin, être reconnu, considéré et pleinement soutenu par les pouvoirs publics.
Ce manifeste pour des ruralités vivantes avance différentes propositions d’évolution. Organisations professionnelles, associations, administrations, élus nationaux et locaux et citoyens doivent s’en saisir. »
https://www.fnsea.fr/wp-content/uploads/2021/09/Manifeste-pour-des-ruralites-vivantes-1.pdf
FORMER
Université Paris-X Nanterre
Intervention dans le Master « Géographie, Aménagement, Environnement et Développement » (GAED) sur le thème : « Vers une gestion en (patrimoine) commun de la qualité de la nature et du vivant : plus qu’une question de ressource et d’usages, un enjeu de prise en charge… Et si le meilleur des relations hommes-nature était à venir ? »
AgroParisTech – Chaire Science Politique, Écologie et Stratégie (SPES)
· Intervention de Didier Christin au sein de la dominante SPES, Module GVSP (gestion du vivant et stratégie patrimoniale) : « Une approche par les communs des transformations agricoles, alimentaires et rurales ».
· Intervention d’Élise Levinson : renforcement de l’encadrement pédagogique du module de 2e année “Gestion patrimoniale des territoires”. Accompagnement des étudiants dans la réalisation et l’intégration d’un audit patrimonial intitulé : « Recherche des conditions et moyens pour une meilleure gestion de la biodiversité en Anjou ; quelles stratégies de facilitation pour une prise en charge territoriale et partagée ? ».
ISARA
Participation au Module de formation « Enjeux, acteurs et politiques. Stratégie, innovation et gouvernance des filières et des territoires » sur le thème « Rôle et place de la gestion en commun avec les agriculteurs dans la gestion durable de « patrimoines – ressources » naturels ».
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Master BIOTERRE
Accompagnement du projet tutoré « Intérêts, conditions et moyens d’un maintien de l’élevage et d’une redynamisation de l’installation en brebis Causses du Lot. En quoi cela est-il porteur de transformations économiques, sociales et environnementales positives pour le territoire des Causses du Quercy ? », conduit par l’équipe enseignante et les étudiants du Master Bioterre dans le cadre du projet « Territoires à Agricultures Positives ». Intervention d’une demi-journée sur le sujet : « Être et agir dans le monde : penser ses interactions avec le vivant ».