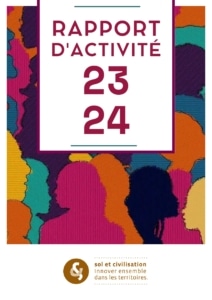Base documentaire
Tribune Ruralité
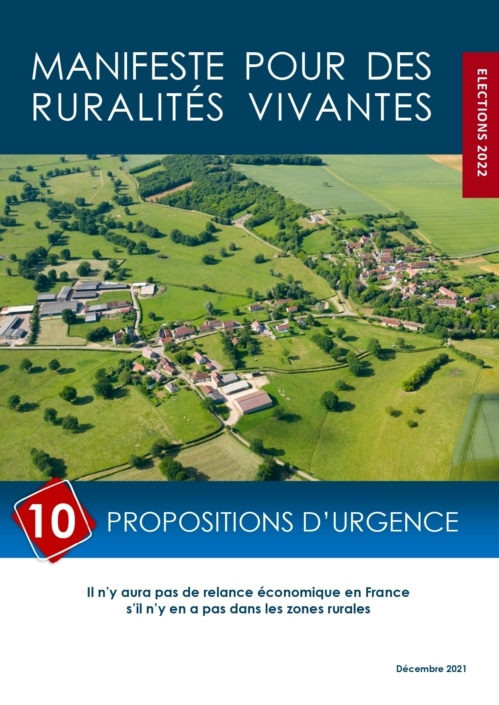
Manifeste pour des ruralités vivantes
Le regard d’un sociologue sur le rural aujourd’hui
Dans cet article, l’auteur propose un diagnostic des différentes réalités de l’espace rural en France et leurs conséquences en termes de stratégie de développement pour les territoires ruraux.
Le regard d’un géographe sur le rural aujourd’hui
Comment la sociologie aborde les sociétés rurales ?
Les piliers du devenir des territoires en Europe
Dans cet extrait du discours de clôture des 20èmes Assises de Sol et Civilisation, l’auteur souligne les trois piliers indissociables pour réfléchir le devenir des territoires européens : l’agriculture, le rural, la relation de l’homme au territoire.
Place de la ruralité et de l’agriculture dans la société française
Dans cet extrait du discours d’ouverture des 20èmes Assises de Sol et Civilisation, l’auteur propose un diagnostic des lignes de tension qui marquent la société française : l’érudit versus le citoyen, les responsabilités individuelles et collectives, l’homme consommateur et l’homme acteur… Il invite à trouver de nouvelles relations en phase avec la recherche de sens de bien vivre qui caractérise une société de plus en plus immatérielle.
L’Etat, le marché, la communauté : comment améliorer la gestion de l’eau ?
L’article fait le point sur quelques enseignements du projet de thèse de Didier CHRISTIN. A la lumière de ses travaux, l’auteur défriche quelques points structurants du paradigme de la gestion de l’eau et nous invite à repenser les binômes « Etat-marché », « liberté-contrainte » si l’on souhaite effectivement améliorer la qualité globale de l’eau.
L’énergie renouvelable au coeur du développement d’un territoire rural, l’exemple du Mené
Cet article fait le point sur les initiatives et les projets portés par les acteurs du territoire du Mené qu’ont présenté Dominique ROCABOY et Jacky AIGNEL lors des Assises 2007 de Sol et Civilisation. Il dégage les différentes innovations dont les acteurs ont fait preuve pour mener à bien ces projets. Ces innovations sont au coeur du projet de territoire et sont révélatrices d’un territoire vivant et ouvert.
La subsidiarité est une question d’actualité
Dans cet article, l’auteur explique en quoi la notion de subsidiarité lui paraît stratégique pour appréhender les évolutions mondiales, pour poursuivre la construction de l’Europe tout comme pour gérer les crises de la société française.
Préserver les lieux où peut se créer le lien social
Dans cet article, l’auteur distingue trois niveaux pour prendre en charge le développement des milieux ruraux : la commune comme lieu de vie, la communauté de communes comme lieu de coopération, le territoire comme espace de projet commun.
L’agriculture, le renversement anthropologique
Dans cet article, l’auteur propose un examen synthétique de la place du monde agricole et rurale dans la société française. Il pointe aussi un paradoxe du regard sur l’agriculture contemporaine : « alors que le secteur d’activité le plus ancien devait être réduit à l’essentiel et se faire oublier, il devient au contraire le symbole de l’altérité à retrouver ».
Finance et éthique, quelle articulation ?
Dans son article, l’auteur tente de reposer les règles de la finance pour en retrouver le sens notamment dans un objectif de développement des territoires.« Finance » et « éthique », rarement deux termes ont été aussi dissonants. Si la finance est utile, il convient donc d’en fixer les règles et le cadre pour qu’elle soit au service du bien commun.
Finances et territoires
Dans cet éditorial, l’auteur revient sur le lien entre finance et territoire, sujet de préoccupation majeure ces dernières années.Depuis la crise des subprimes en 2007 et la faillite de Lehman Brothers en 2008, les crises s’enchaînent par rebonds successifs, toujours plus importantes, toujours plus violentes, des marchés aux banques, des banques aux Etats, des Etats aux sociétés.
Or, la finance est nécessaire à l’économie pour, notamment, fournir de la trésorerie couvrir les risques, financer le capital de départ. Alors peut il y avoir d’autres chemins possibles ? Sommes nous définitivement montés dans un train lancé à grande vitesse, désormais sans réel conducteur, et qui nous dirige vers un précipice ?
Or, la finance est nécessaire à l’économie pour, notamment, fournir de la trésorerie couvrir les risques, financer le capital de départ. Alors peut il y avoir d’autres chemins possibles ? Sommes nous définitivement montés dans un train lancé à grande vitesse, désormais sans réel conducteur, et qui nous dirige vers un précipice ?
Pour une approche stratégique du bien commun
Dans cet article, l’auteur propose d’appréhender la prise en charge des biens communs, tels que la gestion du vivant, avec de nouvelles approches qui visent à organiser la négociation autour des attentes multiples des acteurs concernés.
Typologie des problèmes dans les sociétés : problèmes techniques et problèmes adaptatifs
Ronald HEIFETZ, professeur à l’Ecole d’administration J.F.Kennedy (Université de Harvard), distingue deux types fondamentaux de problèmes rencontrés par les sociétés : les problèmes techniques et les problèmes d’adaptation.
Pour une nouvelle approche du développement, centrée sur l’homme
Dans son discours, l’intervenant tire les enseignements de son intervention auprès de la République du Kirghizitan, menée la fin des années 90 pour élaborer un programme de développement. Quelques points clefs à retenir: la nécessité de 1) considérer les pays non pas comme des marchés émergents mais comme des sociétés émergentes; 2) faire naitre la subsidiarité avant de définir le projet; 3) appréhender le développement comme un problème complexe d’adaptation et non pas comme un problème technique.
La subsidiarité, base de la démocratie
Dans cet article, l’auteur s’inquiète du manque de subsidiarité dans le développement de notre société alors qu’à ses yeux, ce principe est essentiel pour un développement local réussi, incontournable pour poursuivre la construction européenne, et indispensable pour faire émerger un développement mondial cohérent et équilibre…
Les Missions Locales
Présentation de la vocation des Missions locales
Pourquoi les jeunes désertent-ils ?
Dans cet article, l’auteur partage sa préoccupation vis-à-vis du phénomène de désertion des territoires ruraux par les jeunes. Si l’un des enjeux est de mieux accompagner leur insertion professionnelle, la situation nécessite aussi de mieux comprendre pourquoi les jeunes désertent.
La notion de qualité dans l’entreprise
Présentation de la notion de qualité dans l’entreprise, par l’ancien directeur technique du Mouvement français pour la qualité
L’évolution du domaine qualité dans les entreprises
Dans cet article, l’auteur présente les trois étapes principales de l’évolution de la gestion de la qualité dans les entreprises depuis la seconde guerre mondiale. Il insiste sur les nouvelles approches et notions pour développer la qualité dans les entreprises aujourd’hui et voit une grande relation entre ce défi pour le milieu humain qu’est l’entreprise et les enjeux auxquels un territoire est confronté.
Pour des territoires ruraux vivants et entreprenants, des hommes acteurs et responsables
Dans cet article, l’auteur développe les trois dimensions essentielles pour une relance du développement des territoires ruraux : favoriser les relations des hommes entre eux, la vie économique des territoires mais aussi la vie locale et l’organisation des territoires. Il s’agit in fine de trouver les conditions d’application d’une réelle subsidiarité.
Agriculture, société, territoires : des liens porteurs de richesses
Dans cette synthèse de colloque, l’auteur propose de considérer le territoire comme un point de rencontre entre agriculture et société. Parce qu’il est un socle de relations, un espace de ressources et un lieu stratégique pour envisager le développement économique. Ceci d’autant plus que les termes d’un nouveau pacte entre agriculture et société se font jour.
Quelle place pour les territoires ruraux ?
Dans cet article, l’auteur propose une grille de lecture pour guider l’évolution de la place des territoires ruraux dans les équilibres de société. Pour répondre pleinement à leurs trois fonctions économique, naturel et résidentielle, il s’agit d’accompagner l’évolution des relations ville-campagne mais aussi l’organisation des territoires ruraux eux-mêmes, en particulier au niveau de la commune et des pays.
L’association foncière pastorale : un outil de travail
L’association foncière pastorale (AFP) réunit les propriétaires fonciers afin de gérer collectivement un périmètre à l’abandon ou en voie d’abandon. Cinq principaux objectifs sont visés :
Remettre en valeur des fonds de vallées livrés à la friche
Cet article reprend l’intervention de Pierre GRANDADAM lors d’une rencontre sur les problèmes complexes liés au vivant. L’auteur raconte comment, dans un partenariat étroit avec les acteurs du territoire (agriculteurs, propriétaires et habitants), les élus locaux ont initié la remise en valeur des fonds de vallées de la Haute-Bruche. Etape par étape, des outils comme l’association foncière pastorale ont été mobilisé et ont permis d’atteindre des résultats déjà satisfaisants, en particulier pour la qualité du paysage.
Gérer la qualité du vivant : clef de voûte d’un nouveau contrat de société
Dans cet article, l’auteur propose d’aborder les enjeux du développement des territoires et des équilibres de société avec un regard nouveau : celui d’une gestion du vivant réactualisée. C’est pourquoi l’enjeu n’est pas seulement agricole. Pour l’auteur, il s’agit de reconsidérer le contrat entre la société et son agriculture, et plus largement ses territoires ruraux et l’ensemble des acteurs concernés, vis-à-vis de cette gestion du vivant.
Lien entre sol et civilisation : l’eau
Dans cet article, l’auteur propose d’envisager les enjeux de gestion de l’eau comme une opportunité pour positiver la fonction des agriculteurs et plus largement des gestionnaires des territoires ruraux. C’est pourquoi il faut selon lui considérer l’eau comme un « produit du sol » et non pas seulement comme un « don du ciel ».
La SICA et le développement local
Dans cet article, l’auteur souligne l’intérêt, l’originalité et la modernité de l’outil SICA pour accompagner l’aménagement et l’organisation des territoires ruraux. Contrairement aux outils classiques du développement agricole, la SICA est une structure ouverte à l’ensemble des acteurs ruraux d’où probablement de nouvelles opportunités à rechercher aujourd’hui dans l’appui aux dynamiques de « pays ».
Des montagnes, des ours et des hommes
Dans cet article, l’auteur témoigne des racines de son engagement dans les vallées du Haut-Béarn qui d’une situation de crise face au « problème de l’ours » l’ont conduit à porter une démarche patrimoniale pour ré-impliquer progressivement l’ensemble des acteurs qui revendiquent une responsabilité sur ce territoire où vivent les ours… un processus qui pour l’auteur part du principe que chacun dans son domaine ou sa compétence a quelque chose à faire pour le bien commun.
L’audit patrimonial : un outil nouveau au service de l’action en commun
Un audit patrimonial se déroule en général en trois phases.
La première est qualifiée de « macro-systémique ». L’auditeur rencontre les acteurs qui ont une action ou une vision globale de la question :: Conseil Général, Conseil Régional, administrations, chambres consulaires, associations…
La première est qualifiée de « macro-systémique ». L’auditeur rencontre les acteurs qui ont une action ou une vision globale de la question :: Conseil Général, Conseil Régional, administrations, chambres consulaires, associations…
Expliciter un jeu à somme positive : l’exemple de l’orange
Sur une table : une orange et un couteau. Autour de la table : Sophie et Marie.
Comment partager l’orange pour obtenir un jeu à somme positive ?
Comment partager l’orange pour obtenir un jeu à somme positive ?
La goutte d’eau, l’ours et le milieu rural
La goutte d’eau, l’ours et le milieu rural
Le bien commun
Dans cet encart, l’auteur dessine à grands traits sa conception du bien commun… et de sa gestion.
Une gestion en bien commun de leur milieu de vie par des hommes responsables, élément clef du retour à l’équilibre de notre société
Dans cet article, l’auteur précise les principes et objectifs de l’action de Sol et Civilisation, tournée vers un rééquilibrage de la société qui se fonde sur un comportement nouveau des acteurs. L’objectif est bien de promouvoir un Homme actif et responsable et pour cela d’explorer de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour que l’Homme puisse être pleinement acteur de son propre développement. Deux exigences liées ensemble : la recherche-action!
L’innovation agricole et les politiques régionales en Ile-de-France
Dans son discours, l’auteur rappelle la dimension agricole et rurale de la région Ile-de-France, tant sur le plan géographique qu’économique. Dès lors pour le président de la région Ile-de-France, l’enjeu est d’accompagner l’agriculture et l’espace rural pour conduire l’innovation nécessaire face aux défis de compétitivité, pour créer de nouvelles valeurs ajoutées, pour protéger les espaces naturels mais aussi maintenir des territoires vivants.
Vers un projet agricole pour la ville nouvelle de Sénart
Dans cet article, l’auteur retrace à grands traits l’histoire de la ville nouvelle de Sénart et de la place progressive qu’y ont pris les agriculteurs et l’agriculture. C’est ainsi que l’auteur décrit une situation atypique qui mixe agriculture et ville et nécessite de plus en plus de penser le projet agricole comme un projet dans la ville, voire même comme une partie du projet de ville. A travers ce cheminement, l’auteur éclaire les voies de relations nouvelles entre les agriculteurs et les habitants d’un territoire très urbanisé.
La démarche patrimoniale
Dans cet article, les auteurs synthétisent les grandes lignes de la démarche patrimoniale. Centrée sur la gestion du vivant donc la gestion de la complexité, la démarche patrimoniale permet de faire évoluer le comportement d’un ensemble d’acteurs en interaction face à un problème. En illustrant la définition de la « gestion de la qualité du vivant » avec la gestion d’une rivière, les auteurs distinguent les limites des approches universalistes actuelles et propose d’engager une autre voie, celle de l’approche patrimoniale pour accompagner les acteurs vers une meilleure de la gestion du vivant.
Œconomie et territoire, deux retours aux sources pour nous projeter dans le 21e siècle
Dans cet article, l’auteur nous invite à revenir aux sources de « l’économie », c’est à dire à l’oeconomie comme l’art de penser les relations entre les choses et entre les hommes. Pour l’auteur, ce retour à l’oeconomie est évidemment complémentaire d’un retour au territoire, échelle d’organisation du développement économie et social, mais aussi et probablement surtout parce que l’économie réelle repose sur la confiance, dont le territoire est l’un des îlots.
Les transformations des campagnes françaises au début du XXIe siècle
Dans cet article, l’auteur propose en trois temps de reconsidérer les campagnes et d’éclairer leurs transformations. Peut-on encore parler de ruralité ou ne faut-il pas plutôt considérer les ruralités d’aujourd’hui pour décrire les dynamiques des espaces ruraux? L’auteur décrypte ensuite les 7 ruptures qui conduisent selon lui à la recomposition leurs recompositions autour de trois dimensions : agricole, résidentielle et naturelle. Pour assurer un développement local de ces territoires ruraux, il s’agit dès lors de prendre en charge cette recomposition à travers quatre défis.
La gestion des ressources humaines en milieu rural : un défi territorial
Dans cet article, le groupe de Toulouse souligne l’originalité de la gestion des ressources humaines en milieu rural. Pour la prendre en compte, il faut par conséquent développer des outils et des dispositifs spécifiques, appréhender cette problématique de façon transversale, d’où l’intérêt et l’opportunité de faire émerger dans les territoires une organisation tripartite : la triade d’acteurs.
La gestion des ressources humaines en milieu rural : l’exemple du Pays Couserans
Dans cet article, l’auteur détaille une action menée par les élus locaux pour améliorer le développement socio-économique du territoire. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s’y inscrit au travers de la recherche d’un développement local. L’expérience du Pays Couserans illustre l’enjeu que représente, à un moment donné et pour un territoire, la gestion des ressources humaines, ici dans le cadre d’une meilleure structuration des acteurs du territoire.
La gestion des ressources humaines en milieu rural : l’expérience de la coopérative SICASELI
Dans cet article, les auteurs présentent l’exemple du territoire du Ségala-Limargue sur lequel les acteurs économiques – entreprises puis associations – se sont mobilisés pour mettre en place, au fil des années, une gestion progressive de gestion des ressources humaines. Au travers de l’association Mode d’Emploi, du club d’entreprises et de la création d’une CUMA, les acteurs locaux se sont regroupés, organisés et tentent désormais de renforcer la triade d’acteurs. Les auteurs détaillent ainsi leur recherche d’un mode de gouvernance local permettant de répondre aux problèmes de gestion des ressources humaines sur le territoire : déficit de main-d’œuvre et de compétences prévisible dans les années à venir.
L’innovation territoriale de la SICASELI
Dans cet interview, l’auteur éclaire sa conception de l’innovation sur le territoire de la coopérative SICASELI, le Ségala-Limargue, et détaille sa façon de la conduire et de l’accompagner, tant sur le plan technique qu’organisationnel.
Vive l’innovation territoriale !
Dans cet éditorial, l’auteur nous invite à donner une dimension nouvelle au territoire. Certes il est un espace incontournable de rencontre et le socle d’un développement fondé sur la mise en mouvement des hommes, mais il peut aussi être le creuset de l’innovation pour mieux agir ensemble…
La gestion des ressources humaines dans les territoires, une réflexion de longue haleine
Dans cet éditorial, l’auteur reprend l’histoire, l’organisation et la conduite des réflexions du groupe de Toulouse, véritable cheminement d’une préoccupation commune pour l’entrepreneuriat en milieu rural vers l’approfondissement des conditions et moyens d’une bonne gouvernance territoriale, en particulier en matière de gestion des ressources humaines dans les territoires…
La gestion du vivant : une stratégie d’avenir pour la société et l’agriculture
Dans cet article, l’auteur recherche les conditions pour impliquer les agriculteurs et l’agriculture au cœur du projet de développement durable que recherche la société. En revenant sur les critères courants de développement durable, il propose d’éclairer une voie nouvelle fondée sur la prise en charge du vivant dans une approche de qualité totale. Comment les agriculteurs peuvent-ils se saisir du rôle stratégique qu’ils peuvent y jouer ?
Pour une gestion en bien commun du territoire du Haut-Béarn
Dans cet article, l’auteur présente le territoire de l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn, le « pays des hommes et des ours », et rappelle les les origines, les objectifs, et les missions de cette instance : « se concerter, décider et agir ensemble, pour faire en sorte que chacun retrouve sa place, sa dignité, et que sa parole serve au bien commun pour tout le territoire ».
Les entreprises face aux mutations
Dans cet article qui reprend son intervention aux Assises sur l’entrepreneuriat en milieu rural, l’auteur détaille trois principes essentiels à ses yeux pour la compétitivité des entreprises, dans un monde ouvert et changeant : le principe de contingence, celui de changement et enfin le principe de reconnaissance mutuelle.
« Projet de territoire » : définition de termes
Dans cet encart, l’auteur éclaire la distinction entre trois expressions courantes pour évoquer le territoire : projet de territoire, territoire de projets, territoire de programmation.
Le développement territorial : petite ou grande histoire ?
Dans cet article, l’auteur revient sur l’émergence et l’affirmation du concept de développement territorial depuis le milieu du XXème siècle. De l’aménagement du territoire, au développement territorial en passant par l’action locale, il souligne les acquis successifs qui permettent de mieux préciser les enjeux et les défis à relever en ce début de XXIème siècle.
L’audit patrimonial
Présentation succincte de la démarche d’audit patrimonial
L’audit patrimonial, un nouvel outil au service du développement local
Dans cet article, l’auteur raconte l’histoire d’un petit terroir déshérité du Lot qui se découvre une identité positive et dont la population se reprend à croire en elle-même…
La commune est une idée neuve qui s’invente tous les jours à Larrazet, en Tarn et Garonne
Dans cet article, l’auteur témoigne de l’expérience et des initiatives de la commune de Larrazet qui entretiennent au quotidien et dans la durée la responsabilité et l’implication des hommes dans la vie et l’identité culturelle de cette commune du Lot et Garonne.
Des démarches de gestion en commun pour une démocratie réelle et vivante
Dans cet éditorial, l’auteur propose de remettre le lien entre les hommes au cœur du projet de société, d’où l’importance de replacer les hommes, citoyens, élus ou chefs d’entreprise, en condition d’exercer leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté…
Sol et Civilisation, des lieux de réflexion à la fois sociologique, économique et politique
Dans cet éditorial, l’auteur expose les fondements qui le conduisent à proposer de faire de l’association Sol et Civilisation un espace d’interrogation, de réflexion et de débat sur les équilibres d’une société française en crise. En crise au sein du monde rural. En crise au sein du monde urbain. En crise dans la rupture du dialogue et de la connaissance entre les milieux urbains et ruraux…
Discours du Dimanche des Terres de France
Dans ce discours de clôture du Dimanche des Terres de France, l’auteur expose les fondements de la vision qu’il souhaite porter à travers la promotion du développement des territoires ruraux, en particulier en créant par la suite l’association Sol et Civilisation.
Comment aider les grandes organisations à anticiper le changement ?
Dans cet article, l’auteur développe les concepts de cartes mentales et d’organisation apprenante, déduits de l’observation des conditions du changement dans les grandes organisations, et propose d’imaginer un scénario où cette approche de dénominateur maximum commun permettrait non pas de planifier une nouvelle agriculture, mais de dessiner une multitude de petits chemins de changement.
La participation en Chartreuse
En Chartreuse, la participation n’est pas un vain mot !
Le parc naturel régional de la Chartreuse : une machine à créer du dessein commun
Dans cet article, l’auteur livre son retour d’expérience sur la création et les premières années du parc naturel régional de Chartreuse (freins et leviers identifiés, choix d’organisation, outils mis en œuvre, premiers bilans) et soulignent quelques enseignements aux acteurs qui souhaitent porter ce type d’initiative.
L’histoire du processus de certification forestière
Les faits marquants de l’histoire du processus de certification
Gestion durable des forêts
Dans cet article, l’auteur rappelle les liens historiques entre certification forestière et gestion durable des forêts, détaille l’émergence de cette notion en France et en Europe et son appropriation par les forestiers privés et acteurs de la filière bois à travers le système PEFC, qui se distingue de l’approche PFC.
De la gestion durable des forêts
Dans cet article, l’auteur rappelle les liens historiques entre certification forestière et gestion durable des forêts, détaille l’émergence de cette notion en France et en Europe et son appropriation par les forestiers privés et acteurs de la filière bois à travers le système PEFC, qui se distingue de l’approche PFC.
Crise du vivant et stratégies de prise en charge de la qualité commune
Dans son éditorial, l’auteur s’inquiète de la montée des crises du vivant qui annoncent un défi majeur pour nos sociétés : élaborer des stratégies communes pour prendre charge la qualité du vivant par et avec l’ensemble des acteurs concernés, agriculteurs bien sûr, mais aussi acteurs de filière, consommateurs etc.
Politiques territoriales et complémentarités des villes et campagnes
Dans cet éditorial, l’auteur rappelle son souhait de voir les acteurs ruraux pleinement acteurs du développement rural et des complémentarités entre villes et campagnes. Une vision peu compatible avec l’approche urbaine de l’aménagement du territoire, qui guide l’évolution des politiques publiques.
L’adhésion des PECO, aspects socio-économiques
Dans cet article, l’auteur s’inscrit en faux vis-à-vis de la vision courante des agricultures des PECO, souvent perçues comme un avantage comparatif pour l’intégration de ces pays dans l’Union Européenne. En s’appuyant sur l’analyse de la compétitivité agricole, de la productivité, de la structuration des exploitations et en décryptant le retour à la terre comme un refuge anti-chômage, l’auteur propose de considérer le développement économique et agricole de ces pays non seulement comme un projet de développement rural classique mais comme une politique d’organisation et d’aménagement du territoire au sens large, c’est-à-dire des campagnes et des villes et des liens qu’elles peuvent entretenir.
La subsidiarité est-elle possible dans la grande distribution ?
Dans cet article, l’auteur soutient que la grande subsidiarité peut être un espace où s’exerce la subsidiarité. Il développe cette analyse en présentant le groupement des Mousquetaires : sa structuration, sa philosophie et ses modalités de fonctionnement, en tant que tissu de petites entreprises mais aussi en tant qu’ensemble d’individus qui s’engagent à prendre une partie de l’entreprise commune, chacun à leur niveau. Dans un second temps, l’auteur illustre l’action spécifique conduite en milieu rural, à travers des exemples concrets.
La situation démographique dans les nouveaux pays membres de l’Union Européenne
Dans cet article, l’auteur analyse les données démographiques de l’élargissement de l’Union Européenne de 15 à 25 pays membres. En détaillant les différences entre les pays entrants et les 15 – conditions de vie, accroissement naturel, fécondité, flux migratoire -, il éclaire les enjeux d’un rassemblement certes historique, mais pas sans risque pour l’équilibre des territoires concernés et de leurs populations.
Le projet socio-politique du développement durable
Après un bref retour sur l’apparition de la notion de développement durable, symptôme de l’émergence de la complexité du vivant, l’auteur propose quatre leviers pour considérer la gestion du vivant en bonne santé : une exigence de qualité totale, des modalités de prise en charge revisitées, le besoin de piloter la qualité, la nécessité de sécuriser les acteurs dans la prise d’initiative. En conclusion, le développement durable est un choix politique de société.
Urbains, ruraux en Ile-de-France : construire la coexistence
En rappelant les spécificités régionales du lien ville-campagne, l’auteur partage différentes expériences conduites en Ile-de-France qui témoignent des enjeux, des perspectives et des pistes d’amélioration des liens entre développement urbain et développement rural.
Un développement durable au service des montagnards
Dans cet exposé, l’auteur détaille les fondements et origines de la création de l’Association des populations des montagnes du monde et l’intérêt de cette initiative pour alimenter les réflexions mondiales sur le développement durable et en relever les défis. Il s’agit avant tout de maintenir des hommes dans ces espaces montagnards, notamment pour préserver les équilibres naturels de ces territoires, mais aussi pour aider la société et chacun de nous à repenser son rapport à la nature, à son milieu et au monde.
Pour le plein emploi des territoires et des hommes
Après un rapide panorama historique des gains de productivité, mais aussi de la baisse des prix agricoles, des revenus et de la marginalisation des populations agricoles et rurales, l’auteur explore les conditions permettant de relever le défi alimentaire mondial tout en maintenant des territoires ruraux vivants, en particulier en termes d’organisation mondiale des marchés des produits agricoles.
Une volonté : faire vivre le territoire et les acteurs du Comté
Chaque type d’acteurs assume pleinement sa fonction au sein de la filière (production, transformation, affinage, vente) et prend part à la gestion de l’ensemble. L’outil commun dont ils se sont dotés, gère la filière au mieux de leurs intérêts.
La filière Comté : au service des hommes qui en vivent
Dans cet article, l’auteur présente l’expérience de la filière Comté et explique comment l’organisation des acteurs locaux favorise tout à la fois la sécurité économique de la filière, une démarche qualité vis à vis des productions, mais aussi une prise en compte plus fine de l’environnement et des demandes du consommateur.
Y a t-il déménagement du territoire ?
En questionnant les dynamiques d’aménagement et de développement territorial en France, l’auteur décrit des processus territoriaux en cours - le vieillissement démographique, l’évolution de l’accroissement naturel, l’héliotropisme, la concentration, la différenciation, etc. – pour identifier un ensemble de « maladies territoriales » touchant à l’urbanisation, aux services publics, à la décentralisation, au lien ville-campagne, aux inégalités de communication, etc. In fine, l’enjeu est de réactualiser la vision du territoire, non comme une contrainte, mais une ressource voire une chance pour résoudre ces problèmes.
La Thiérache
La Thiérache est une région naturelle, à cheval sur 3 départements : Aisne, Nord et Ardennes. Une partie se trouve en Belgique. Cette zone frontalière a connu de nombreuses guerres. C’est un pays de bocages, de forêts et de rivières. Les paysages sont très réguliers. L’identité culturelle est forte.
La subsidiarité en Thiérache, intérêts et principes
La communauté de communes gère ce que les communes ne pourraient pas prendre en charge seules, au mieux de l’intérêt des habitants. Les communes conservent les autres compétences, leur autonomie. Elles participent toutes, du fait du mode de représentation choisi, à la vie de la communauté de communes.
La subsidiarité est un atout pour la gestion des territoires
Dans cet article, l’auteur revient sur l’organisation de son territoire en intercommunalité. Avant d’être une question d’organisation, il s’agit avant tout de faire émerger un projet de territoire qui permette d’agir ensemble et de répondre à de nouveaux enjeux (tourisme, gestion des déchets) pour maintenir in fine le développement économique et la vitalité des communes tout en préservant une forte capacité de décision et d’action des élus locaux.
Le libéralisme exacerbé actuel est-il compatible avec la vie des territoires ?
Dans cet article, l’auteur rappelle les traits essentiels de la mutation de la société suscitée par la mondialisation et le progrès technique, afin d’éclairer trois options de société pour le futur. Il souligne ensuite quelques problèmes principaux à dépasser pour que libéralisme et vie des territoires se renforcent : relier le marché et les institutions, favoriser la construction européenne, revisiter le développement durable. D’où la possibilité d’appréhender le territoire avec un regard nouveau, c’est à dire comme un lieu de réconciliation, d’enracinement, de relation, d’équilibre et donc de vie.
De la gestion de la vallée de l’Ardèche
Dans cet article, l’auteur présente les premiers résultats d’une démarche initiée dans la vallée de l’Ardèche afin de mobiliser les acteurs autour des enjeux de la gestion de l’eau.
La situation des territoires ruraux en Pologne
Dans cet article, l’auteur détaille l’organisation et le fonctionnement des espaces ruraux polonais, et explore les principaux enjeux en termes de développement agricole et d’organisation territoriale. Penser le devenir de ces territoires ruraux et maintenir des territoires vivants, c’est avant tout se donner les moyens d’une politique européenne de la ruralité, et non seulement de l’agriculture…
Place de l’agriculture, entre nature et culture
Dans cet article, l’auteur analyse le glissement progressif des gestionnaires des espaces protégés d’une conception de la préservation de la nature à une vision nouvelle, « la co-gestion de la biodiversité », pour en détailler ensuite les conséquences pour les milieux et les relations entre les hommes. Ce changement sémantique suffira-t-il néanmoins à rétablir la confiance entre « gens du lieu » et « protecteurs » ?
Agriculture, biodiversité et territoires
2010 fut l’année mondiale de la biodiversité.
Sa protection est aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur pour l’ensemble de l’Humanité et un révélateur de la capacité de notre civilisation à répondre en plus des nôtres, aux besoins d’autres espèces. L’immense défi que nous devons tous relever consiste à proposer ensemble un projet de développement équilibré.
Sa protection est aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur pour l’ensemble de l’Humanité et un révélateur de la capacité de notre civilisation à répondre en plus des nôtres, aux besoins d’autres espèces. L’immense défi que nous devons tous relever consiste à proposer ensemble un projet de développement équilibré.
Le regard d’un économiste sur le rural aujourd’hui
Dans cette interview, Francis AUBERT souligne les différents regards portés sur la ruralité à travers l’Europe. Il propose quelques grilles de lecture pour mieux comprendre les avantages économiques qui distinguent les espaces urbains des territoires ruraux.
La relation de l’homme à son espace : une des clefs d’un développement durable
Dans ce discours, l’auteur rappelle les fondements de la création de Sol et Civilisation dont le cœur des préoccupations est de questionner la relation de l’homme à son espace, comme une des clefs d’un développement durable qui permet de rétablir des équilibres.